Une analyse pionnière du bilan carbone dans le domaine de la création artistique
|
EN BREF
|
Une étude initiée par la direction générale de la création artistique vise à évaluer l’empreinte carbone du secteur artistique en France. Réalisée par le cabinet PwC, cette recherche s’appuie sur les données collectées au sein de référentiels carbone, permettant ainsi un accompagnement des structures artistiques subventionnées. Les résultats révèlent que les émissions de gaz à effet de serre (GES) du secteur subventionné s’élèvent à 400 kilotonnes de CO²e par an. En extrapolant ces chiffres, l’ensemble du secteur de la création artistique est estimé à 8,5 millions de tonnes de CO²e annuellement, représentant 1,3% de l’empreinte carbone totale de la France. Les analyses mettent en lumière les principaux postes émetteurs, notamment la mobilité des spectateurs et l’achat de biens et services. Cet effort de mesure et d’évaluation est crucial pour orienter les politiques publiques vers une transformation écologique du secteur.
Le secteur de la création artistique est souvent perçu comme un domaine éloigné des préoccupations environnementales, pourtant, il génère d’importantes émissions de gaz à effet de serre (GES). Récemment, une étude pionnière menée par le ministère de la Culture a permis d’évaluer précisément l’empreinte carbone de ce secteur dynamique. Cette analyse révèle non seulement le poids environnemental de la création artistique, mais aussi les pistes de réduction à envisager pour une pratique plus écoresponsable. Cet article explore les résultats de cette étude et les implications qu’elle peut avoir pour les artistes, les institutions culturelles et le grand public.
Un cadre de référence pour l’évaluation de l’empreinte carbone
Initiée par la direction générale de la création artistique, cette étude sur l’empreinte carbone vise à établir un cadre solide pour le calcul et la réduction des émissions de GES au sein de ce secteur. En coopération avec le cabinet PwC et le Département des études, de la prospective, des statistiques et de la documentation (DEPS-DOC), les chercheurs ont élaboré une méthodologie rigoureuse pour collecter, analyser et interpréter les données relatives à l’impact carbone des pratiques artistiques.
La démarche s’inscrit dans le cadre du guide d’orientation du ministère de la Culture, rendant ainsi ses résultats particulièrement significatifs pour le secteur. Un élément clé de cette évaluation est le recours à des référentiels carbone, permettant d’encadrer et de guider les structures culturelles dans l’analyse de leur propre impact environnemental.
Une collaboration essentielle avec les acteurs de la création
Ce projet n’a pas été mené de manière isolée. En effet, il s’est construit grâce à la participation active de 11 labels et de 5 réseaux professionnels du secteur. Les équipes artistiques, les festivals et les associations professionnelles ont été pleinement impliquées dans le processus d’évaluation, garantissant ainsi une approche collective et représentative des enjeux rencontrés.
Parmi les actions clés mises en place, l’étude a permis de :
- Former les équipes aux enjeux liés à l’énergie et au climat, ainsi qu’aux pratiques permettant de réduire leur empreinte carbone, comme l’écoconception.
- Réaliser plus de 100 bilans carbone, offrant un aperçu précieux sur les émissions du secteur.
- Élaborer collectivement un plan d’action adapté à chaque réseau pour identifier les leviers à activer en matière de réduction des émissions, ainsi que les bonnes pratiques à intégrer.
Un constat alarmant : les chiffres de l’empreinte carbone
Les résultats de l’étude révèlent une empreinte carbone significative pour le secteur de la création artistique. Les émissions de GES de la création artistique subventionnée ont été estimées à 400 kilotonnes de CO²e par an, représentant 5 % des émissions totales du secteur. Ce chiffre met en lumière l’importance d’agir pour réduire cet impact. En parallèle, l’extrapolation des données a permis d’estimer que l’ensemble du secteur de la création artistique pourrait émettre environ 8,5 millions de tonnes de CO²e annuellement, soit 1,3 % de l’empreinte carbone totale de la France.
Pour contextualiser cette donnée, le rapport souligne que la part des émissions du transport aérien intérieur s’élève à 0,7 %, tandis que le numérique représente 4,4 % et le tourisme 15 %. Il est crucial de prendre conscience de ces chiffres pour orienter les politiques culturelles vers une transition écologique et encourager l’adoption de pratiques durables au sein du secteur.
Des sources d’émission à prioriser
Les données recueillies permettent d’identifier les principaux postes d’émission au sein du spectacle vivant et des arts visuels. Pour le spectacle vivant, il a été constaté que :
- La mobilité des spectateurs constitue le premier poste d’émission, représentant 38 % des émissions du secteur, bien en dessous des attentes initiales.
- Les achats de biens et services, comprenant des biens tels que les décors, costumes et accessoires, constituent également une part significative, avec 25 % des émissions.
- Les achats amortissables (comme les véhicules, bâtiments et équipements) représentent 10 % des émissions.
Pour les arts visuels, les résultats montrent une tendance similaire, la mobilité des visiteurs étant la source majeure d’émissions avec 65 % du total, suivie par les achats, qui comptent pour 19 %.
Initiatives écologiques à mettre en avant
Face à ce bilan préoccupant, certaines initiatives émergent pour atténuer l’impact environnemental du secteur. Des collaborations comme celle du collectif 17h25, qui regroupe des institutions telles que le Théâtre du Châtelet et l’Opéra de Paris, illustrent ces efforts. Ensemble, ils travaillent à standardiser les châssis de décors pour réduire le transport lors des tournées. Cette approche démontre qu’il est possible d’adopter des solutions collectives et innovantes pour minimiser les déplacements et, par conséquent, les émissions.
De plus, le collectif Scénogrrrraphies, constitué de professionnels de la scénographie, a élaboré une plateforme nommée « écothèque » pour favoriser le partage de ressources et de connaissances en matière de scénographie durable. Une prise de conscience de l’importance de l’échange et de l’innovation dans le processus créatif est en train de naître, renforçant ainsi l’engagement en faveur de pratiques écoresponsables.
L’avenir du secteur artistique : vers une neutralité carbone
Les résultats de cette étude ont été dévoilés au public lors du Festival d’Avignon en juillet, marquant une étape importante dans la reconnaissance des enjeux environnementaux au sein du domaine artistique. Il est prévu que les résultats détaillés sur les arts visuels et l’enseignement supérieur soient présentés à la rentrée 2025. En s’inscrivant dans la 3e Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC), cette étude contribue à identifier les leviers de réduction des émissions à l’échelle nationale, tout en intégrant le secteur artistique dans une trajectoire de neutralité carbone d’ici 2050.
Les résultats de cette analyse offriront également des perspectives pour les politiques publiques en vue de favoriser la transformation écologique de la création artistique, promouvant ainsi une optimisation des leviers de réduction des émissions de GES.
Les défis à surmonter pour une transition réussie
Néanmoins, la mise en œuvre de ces changements ne se fera pas sans défis. La prise de conscience des enjeux environnementaux, l’émergence de nouvelles pratiques durables et l’engagement des acteurs de la création artistique devront s’articuler autour d’une vision collective. Les institutions culturelles et les artistes doivent être accompagnés dans ce processus de transformation, en bénéficiant de ressources, de formations et de financements pour intégrer les nouvelles normes écologiques dans leur fonctionnement quotidien.
Une éducation à l’impact environnemental dans les arts
Des programmes éducatifs et des actions culturelles émergent également, intégrant la notion de bilan carbone dans leurs initiatives. En combinant créativité et sensibilisation, certaines propositions artistiques visent à éveiller les consciences du public sur l’impact de ses choix en matière d’environnement. Des actions telles que des ateliers artistiques écoresponsables ou des expositions thématiques sur le développement durable permettent d’engager les citoyens dans une démarche positive et proactive.
Il sera donc essentiel que le secteur artistique, en s’appuyant sur les résultats de cette étude, parvienne à se transformer et à se renouveler, en intégrant durablement les enjeux environnementaux dans sa pratique créative. Des liens de collaboration doivent être tissés entre les artistes, les institutions et les acteurs de la transition écologique.
Sans conclusion, faisons en sorte que la prise de conscience des enjeux environnementaux et la volonté de s’engager pour une création artistique durable deviennent les moteurs de cette transformation essentielle qui permettra au secteur d’œuvrer pour l’avenir de notre planète.

La réalisation de la première étude sur l’empreinte carbone du secteur de la création artistique marque une avancée significative dans la compréhension des enjeux écologiques qui touchent ce domaine. En effet, l’initiative du ministère de la Culture, mise en œuvre avec le soutien du cabinet PwC, vise à établir un diagnostic complet de l’impact carbone des activités culturelles.
Ce travail de fond a permis de récolter des données précieuses, révélant que le secteur subventionné émet environ 400 kilotonnes de CO²e annuellement. Cette découverte, loin d’être anodine, souligne la nécessité pour les acteurs culturels de prendre conscience de leur responsabilité écologique et de s’engager dans des pratiques durables.
Dans le cadre de cette étude, des professionnels de la création, tels que des artistes et des responsables de festivals, se sont mobilisés pour évaluer leur empreinte carbone. Leurs témoignages mettent en lumière l’importance d’une telle démarche, non seulement pour minimiser l’impact environnemental, mais aussi pour inspirer un changement dans les mentalités au sein du secteur.
Les participants notent que cette expérience collective a suscité un éveil des consciences au sujet des enjeux énergie-climat. En apprenant à identifier les leviers d’action, ces professionnels ont pu élaborer des stratégies pour réduire leur empreinte, incluant des initiatives comme l’écoconception, la promotion de la mobilité durable et l’utilisation d’énergies renouvelables.
Un aspect particulièrement innovant de cette étude est l’idée de standardiser des pratiques, notamment dans le transport de décors. Les collaborations entre institutions, comme celles du collectif 17h25, témoignent d’une volonté collective de réduire l’impact des tournées, ce qui pourrait instaurer de nouveaux standards dans la création artistique.
Enfin, les résultats de l’analyse ne sont pas uniquement des chiffres, mais ouvrent la voie à un engagement à long terme pour le secteur. La publication prochaine des données sur l’ensemble des arts visuels et de l’enseignement supérieur renforcera cette dynamique, en permettant à tous les acteurs de se projeter vers un avenir plus durable et respectueux de l’environnement.



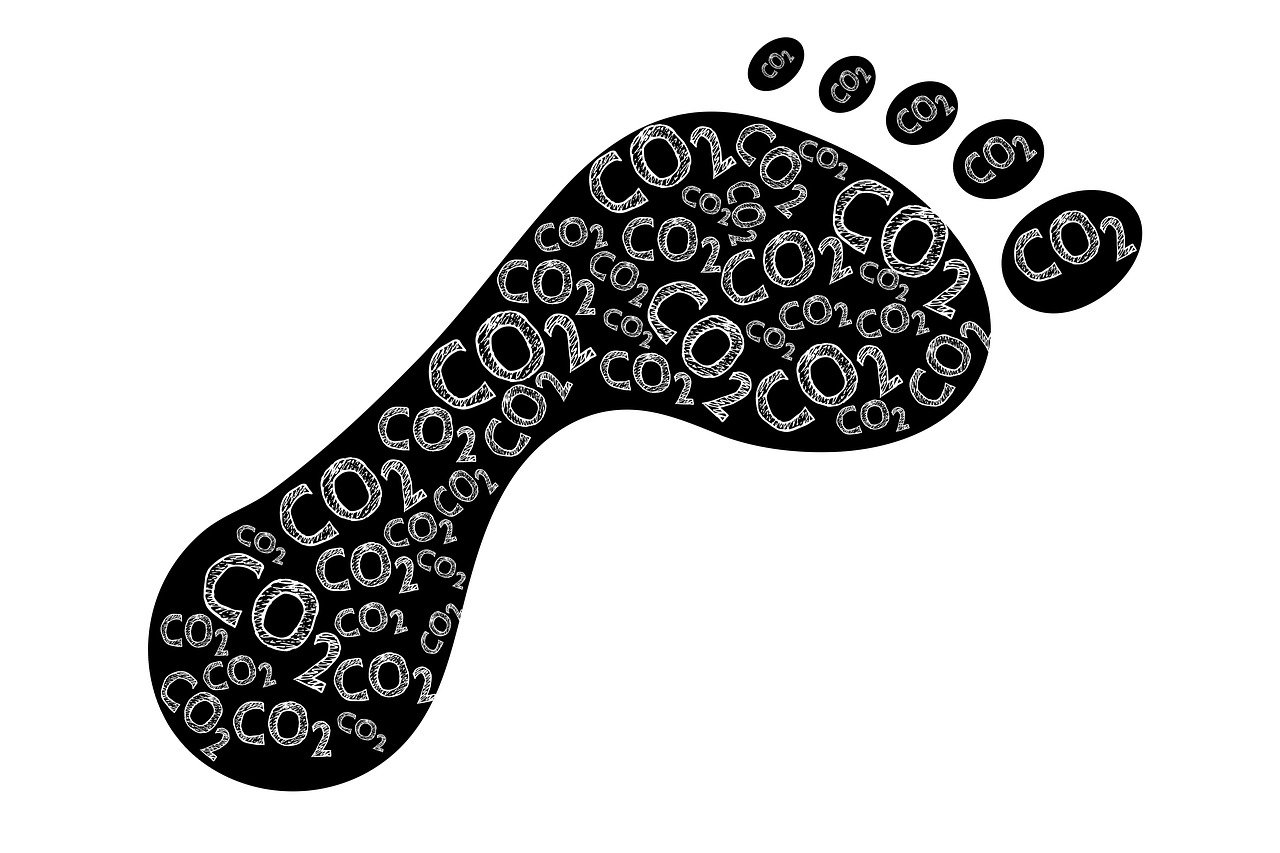








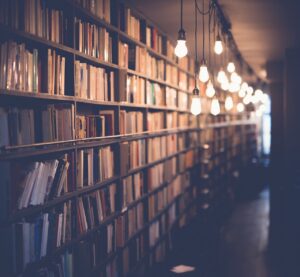


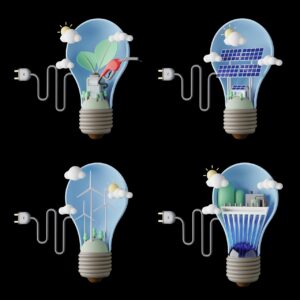


















Laisser un commentaire