L’université de Montréal présente son bilan carbone inaugural
|
EN BREF
|
L’Université de Montréal a récemment publié son premier bilan carbone vérifié pour l’année 2022-2023, révélant des émissions de plus de 63 000 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone (t éq. CO2). Ce rapport répartit les émissions en trois périmètres : les émissions directes, l’électricité achetée et les émissions indirectes, les déplacements quotidiens des usagers et les approvisionnements en biens étant les principales sources. L’université vise une réduction de 20% d’ici 2025, renforçant ainsi son engagement envers la transition écologique et la carboneutralité d’ici 2040.
Récemment, l’Université de Montréal a dévoilé son premier bilan carbone vérifié, une démarche cruciale qui met en lumière ses émissions de gaz à effet de serre (GES) pour l’année 2022-2023. Cette analyse, dépassant les 63 000 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone (t éq. CO2), est divisée en trois périmètres distincts : les émissions directes, l’électricité achetée et les émissions indirectes. Ce document offre également une feuille de route vers la carboneutralité, tout en détaillant les méthodologies et initiatives mises en place pour compenser ces impacts environnementaux.
Un aperçu des émissions de gaz à effet de serre
Pour la première fois, l’Université de Montréal a soumis un rapport détaillant ses émissions de gaz à effet de serre dans le cadre d’une volonté sérieuse d’analyser et de réduire son empreinte écologique. Pour l’année académique 2022-2023, la totalisation des émissions de GES a atteint plus de 63 000 t éq. CO2, un chiffre qui illustre l’ampleur des efforts nécessaires pour engager une transition vers des pratiques plus durables.
Ce bilan est structuré autour de trois périmètres essentiels. Le premier périmètre englobe les émissions directes de l’université, incluant principalement les impacts du chauffage au gaz naturel, qui représente la majeure partie des émissions avec 26 852 t éq. CO2. Les véhicules de service et les fuites de réfrigération contribuent également à ce premier périmètre, avec un total de 28 400 t éq. CO2.
Le deuxième périmètre se concentre sur l’électricité achetée, affichant des émissions significativement plus faibles de 254 t éq. CO2, principalement grâce à l’utilisation de l’hydroélectricité, qui est une source majeure au Québec. En revanche, le troisième périmètre, qui est le plus vaste, aborde les émissions indirectes liées aux déplacements quotidiens des usagers, aux voyages d’affaires, ainsi qu’aux approvisionnements en biens et services, atteignant un total de 34 583 t éq. CO2.
Une méthodologie de collecte des données rigoureuse
La collecte des données pour ce bilan a été effectuée par diverses unités au sein des différents campus de l’Université de Montréal, dont ceux de Saint-Hyacinthe, Laval, le campus MIL et la Station de biologie des Laurentides. Ces données ont ensuite été soumises à l’analyse de l’Unité du développement durable et ont été vérifiées par un auditeur externe, Enviro-accès.
Cette rigueur dans le processus de collecte et d’analyse assure la fiabilité des résultats présentés, permettant à l’université d’avoir une vision claire de son impact environnemental. Grâce à ce travail méthodique, l’UdeM établit une base solide pour le suivi de ses actions et l’évaluation de ses objectifs de réduction des émissions de GES.
Les effets du choix de l’année de référence
Les responsables du développement durable à l’Université ont choisi l’année 2004-2005 comme référence pour établir des objectifs de réduction des émissions. Ce choix est aligné avec l’Accord de Paris, qui a fixé cette année comme point de départ pour les efforts de réduction des émissions au Canada. Cette approche permet à l’université de se conformer aux normes internationales tout en visant une diminution significative de son empreinte carbone.
Une stratégie pour la carboneutralité
À travers ces résultats, l’Université de Montréal a élaboré une feuille de route claire vers la carboneutralité, avec des objectifs établis pour les périmètres 1 et 2. Le coordination du développement durable et le conseiller à la lutte contre les changements climatiques, Stéphane Béranger et Thierry Gras Chouteau, ont déclaré que l’université vise à réduire ses élections de GES de 20 % d’ici 2025 par rapport à 2004-2005, avec des objectifs de 40 % d’ici 2030, et l’atteinte de la carboneutralité en 2040.
Pour y parvenir, une des mesures prioritaires est l’électrification du chauffage, notamment par le remplacement des chaudières à gaz naturel par des chaudières électriques. L’application de ces changements est attendue pour générer une réduction d’au moins 5 000 t éq. CO2.
Une initiative de compensation des émissions
Pour accompagner ses efforts de réduction, l’Université de Montréal a élaboré un fonds carbone. Ce fonds vise à compenser les GES émis à travers les déplacements professionnels des membres du personnel. En investissant dans des initiatives permettant de compenser cet impact, l’université démontre sa volonté d’agir de manière responsable envers l’environnement.
Cette approche souligne l’importance de la responsabilité sociale des institutions d’enseignement supérieur dans la lutte contre le changement climatique ; elle reflète une prise de conscience croissante au sein de l’académie sur la nécessité de contribuer positivement à l’environnement.
Une application pour sensibiliser les utilisateurs
L’Unité du développement durable a également mis en place une application mobile gratuite permettant aux utilisateurs de calculer leur propre empreinte carbone. Cette application, accessible sur le site de l’unité, permet de mesurer les émissions de GES engendrées par les déplacements professionnels et pendulaires, mais également celles liées à l’alimentation.
En facilitant cette démarche intellectuelle et pratique, l’université encourage non seulement ses membres, mais aussi la communauté à intégrer une conscience écologique dans leur quotidien. Cette méthode d’approche personalise aussi les actions pour l’environnement et aide à sensibiliser au rôle que chacun peut jouer dans la réduction de l’impact carbone général.
Pour télécharger l’application, il suffit de visiter le site de l’Unité du développement durable. Cette initiative innovante représente une avancée significative dans l’engagement de l’UdeM envers la sensibilisation environnementale.
Les impacts comparatifs sur le paysage éducatif québécois
Dans le cadre de ses efforts, l’UdeM se positionne dans une moyenne comparable avec d’autres établissements d’enseignement supérieur au Québec tels que l’université McGill, l’Université de Sherbrooke et l’Université Laval. Le bilan carbone vérifié renforce la position de l’Université de Montréal dans le paysage éducatif en matière de durabilité, posant des bases solides pour créer un futur plus vert et plus durable.
Des initiatives similaires sont en cours dans d’autres institutions, et cette publication pourrait potentiellement encourager un émulation au sein du secteur éducatif. En s’appuyant sur des résultats comparables, chaque institution peut établir un cadre référentiel pour mieux évaluer ses émissions de GES.
Le chemin à parcourir
Malgré la réalisation de ce premier bilan carbone vérifié, il est clair qu’il reste un travail considérable à faire. Les enjeux liés à la transition écologique sont vastes et nécessitent des actions pertinentes à tous les niveaux de l’institution. C’est une responsabilité qui s’étend à chaque membre de la communauté universitaire.
Au fur et à mesure que l’université avancera dans la mise en œuvre de ses stratégies de réduction des émissions, il sera essentiel de continuer à communiquer efficacement les progrès réalisés aux parties prenantes, d’assurer une évaluation régulière des initiatives adoptées et de maintenir un dialogue ouvert sur les défis qui subsistent dans cette lutte contre les changements climatiques.

Témoignages sur le bilan carbone inaugural de l’Université de Montréal
« L’Université de Montréal a ouvert la voie avec ce premier bilan carbone vérifié. Pour nous, étudiants, c’est un pas important vers une éducation durable. Cela montre que l’institution ne se contente pas d’enseigner les enjeux environnementaux, mais qu’elle les applique également sur son propre campus. »
« En tant que membre du personnel, je suis fier de travailler pour une université qui s’engage à réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Ce rapport nous donne une base solide pour suivre les progrès réalisés. La mise en lumière des chiffres concrets inspire la confiance et la responsabilité chez chacun d’entre nous. »
« Les résultats partagés dans ce bilan sont à la fois rassurants et incitatifs. Savoir que nos efforts sont mesurés et qu’une stratégie de réduction a été mise en place jusqu’en 2040 est un message positif pour tous ceux qui se préoccupent de l’avenir de notre planète. »
« Le fait que l’Université prenne des mesures pour compenser ses émissions de gaz à effet de serre démontre une volonté d’agir. C’est un excellent exemple à suivre pour d’autres établissements d’enseignement supérieur qui souhaitent s’engager dans une transition écologique. »
« J’apprécie particulièrement l’initiative de l’université d’aider chaque membre de la communauté à comprendre son empreinte carbone personnelle. Cela souligne que chaque individu a un rôle à jouer dans la lutte contre le changement climatique, et que même des petits gestes peuvent avoir un impact significatif. »



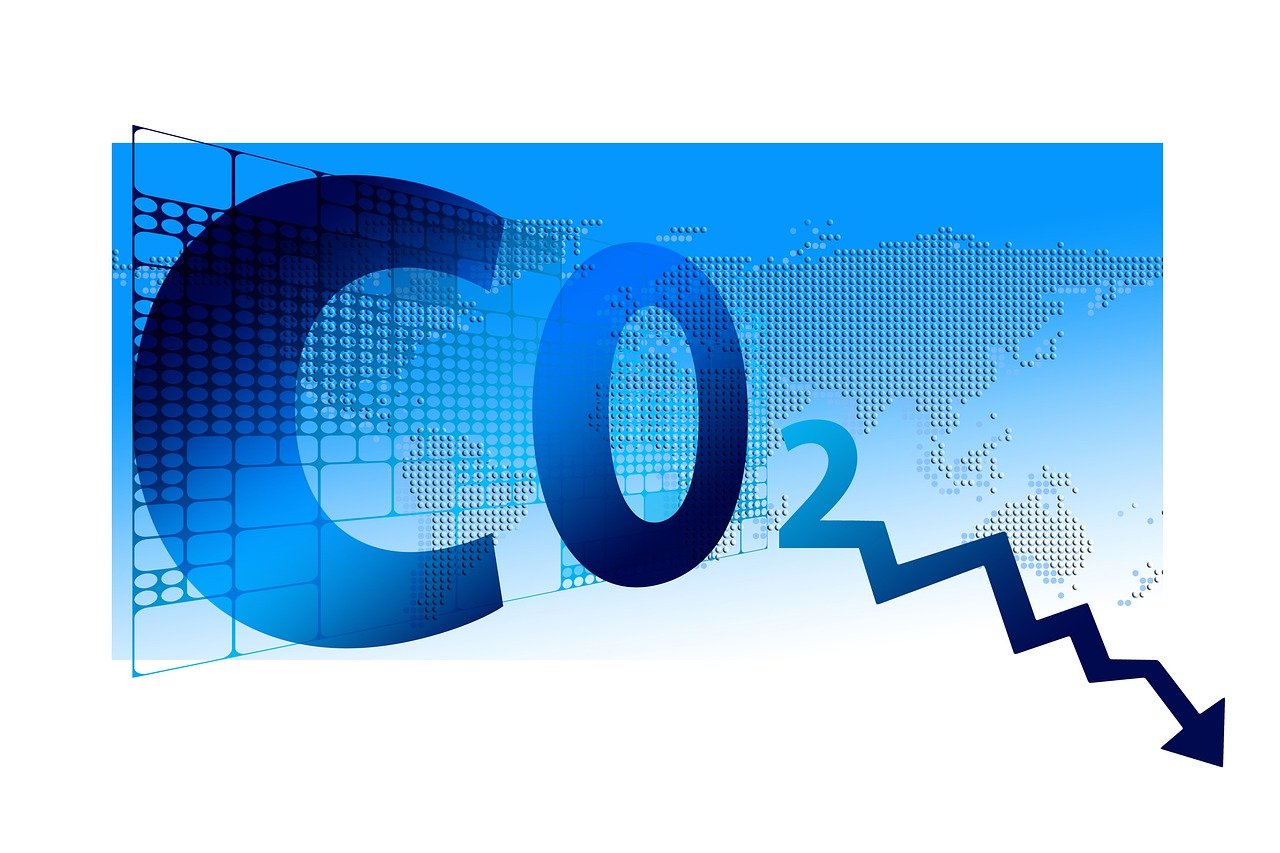








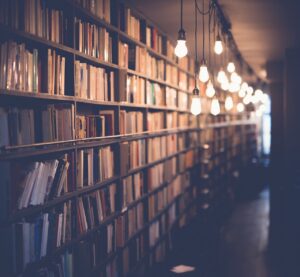


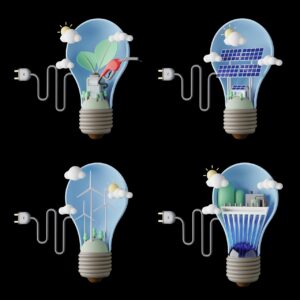


















Laisser un commentaire